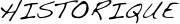La mer est un espace peu sûr. Depuis le Moyen-Age, corsaires et pirates chassent les navires de commerces pour s'emparer de leurs cargaisons. Si l'âge d'or de la guerre corsaire en Méditerranée se situe dans la première moitié du XVIIe siècle, toutefois, le transport maritime continue d'en être affecté jusqu'au début du XIXe siècle. Les corsaires barbaresques installés à Alger, Tunis et Tripoli, font peser une menace permanente sur les côtes de Méditerranée occidentale en s'emparant des marins et des pêcheurs pour les emmener comme esclaves au Maghreb. La mer est aussi le théâtre de batailles navales entre les flottes des Etats qui cherchent à contrôler la voie maritime. Français et Espagnols s'affrontent autour des îles de Lérins entre 1635 et 1637. En Provence, nombreux sont les marins à avoir combattu. L'Amiral de Grasse, né le 13 septembre 1722 au Bar-sur-Loup, s'illustre pendant la guerre d'indépendance américaine de 1776 à 1783. Sous la Révolution et l'Empire, les corsaires Français sont utilisés pour forcer le blocus continental imposé par l'Angleterre et pour perturber ses voies de communication maritimes. Le corsaire niçois Joseph Bavastro s'illustre lors du siège de Gênes puis écume les côtes espagnoles au voisinage de Gibraltar capturant de nombreux navires anglais.
Jusqu'à la Révolution, la contrebande était punie des galères pour les hommes et de bannissement pour les femmes ! Le tabac et le sel occupent les premières places de la contrebande. Le tabac est introduit en France au milieu du XVIe siècle, d'abord grâce au moine André Thevet, qui importe les premières graines, puis par Jean Nicot, qui le recommande, sous forme de poudre, à Catherine de Médicis pour soigner les migraines de François II. Produit d'importation, il est soumis à un droit de douane, en 1629, par Richelieu. Sept ans plus tard les premiers plants sortent des terres de l'actuel Lot-et-Garonne. D'abord affermée à des particuliers puis à la seule Compagnie des Indes, la tabaculture devient monopole d'Etat par décret de Colbert en 1674. Une fiscalité contraignante puis, en 1719, une interdiction de cultiver l'herbe à Nicot partout en France, à l'exception de la Franche-Comté, de l'Alsace et de la Flandre, favorisent l'apparition d'un marché parallèle.
Dans les Alpes-Maritimes, le col de Tende, auquel on accède par l'impressionnante vallée de la Roya, est l'un des seuls points de passage naturel entre la France et l'Italie. C'est cette voie escarpée qu'empruntent les longues caravanes muletières ou les convois de charrettes chargées de sel mais aussi d'huile, de brebis, de métaux, de tissus. Le Piémont fournit en retour des ânes, des toiles, du riz, de la farine de maïs, du tabac.
LA CONTREBANDE MARITIME:
D'où il est question de la franchise de la ville de Nice et du comté.
"le port de Nice est soumis pour les droits de navigation aux mêmes règles que les autres ports de Sardaigne; on y paie comme partout ailleurs les droits de tonnage, de stallage, de carénage.
La ville au contraire et une partie assez considérable du comté, ont le privilège de recevoir exempts de droits de douane toutes les marchandises et denrées qui lui arrivent de l'étranger, à l'exception des blés, des sels et de la poudre qui sont prohibés ou soumis à un droit spécial."
On y retrouve en particulier:
la contrebande du sel
la contrebande des tissus anglais
la contrebande des sucres
la contrebande du tabac